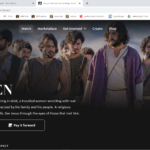- Les belles figures de l’histoire ! Ste Marie-Madeleine
- Portrait
Qui est vraiment Marie Madeleine? Que connaissons-nous d’elle? Aller aux sources: les évangiles. Là est son portrait.
- Marie-Madeleine vue par les artistes
Peintures et sculptures à travers les âges…
- Les grands sanctuaires de Marie-Madeleine
- Marie-Madeleine en Provence?
A t-elle vraiment fini sa vie en France, dans la grotte de la Ste Baume? Est-ce une légende? Que dit la tradition Provençale ? Et la tradition orientale ?
- L’amoureuse de Jésus?
Était-elle oui on non la maîtresse de Jésus? Quelle relation fut la leur? Un amour jusqu’où ? Que nous disent les textes apocryphes et gnostiques ?